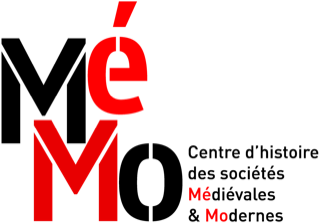Version française / Les membres / Soutenances
LOUIS GEORGES - Soutenance de thèse
Publié le 24 octobre 2025
–
Mis à jour le 17 novembre 2025
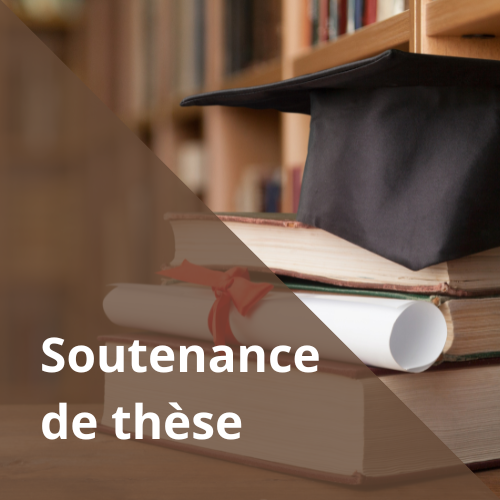
L’heure à Paris. Histoire sociale et urbaine de l’information horaire (1585-1740).
Date(s)
le 6 décembre 2025
9h.
Lieu(x)
Université Paris Nanterre.
Salle B015 (bâtiment B - Pierre Grappin).
Salle B015 (bâtiment B - Pierre Grappin).
Section CNU : 22 - Histoire/civilisations : mondes modernes.
Unité de Recherche : MéMo.
Directeur : M. Nicolas SCHAPIRA, Professeur des universités.
Jury :
Mme Liliane Hilaire-Pérez, Université Paris-Cité et EHESS (rapporteure)
M. Raphaël Morera, CNRS (rapporteur)
M. Gianenrico Bernasconi, Université de Neuchâtel
M. Robert Descimon, EHESS
Mme Corine Maitte, Université Gustave Eiffel
Résumé :
Ce travail propose d’étudier les formes, les acteurs et les pratiques du temps horaire à Paris à l’époque moderne. L’heure y est envisagée comme une information produite, diffusée et appropriée dans la ville : il s’agit de dépasser une approche limitée aux seules innovations techniques (comme la pendule ou le ressort spiral) au profit des interactions entre citadins, signalement de l’heure et paysage urbain. Ces relations évoluent au fil d’un long XVIIe siècle : notre parcours débute sur le pont au Change en 1585, devant l’horloge du Palais reconstruite pour Henri III, pour y revenir à la fin des années 1730, lorsque Jacques Cassini trace le « méridien de la Ville », instrument de référence pour le réglage des montres.
L’objet principal est l’heure de la rue, produite par un environnement signalétique dense et varié : horloges en gros volume, timbres et cloches, cadrans solaires et lignes méridiennes. L’étude se décline en trois axes : les acteurs produisant et entretenant l’information, le rapport de l’heure sonnée et affichée à l’espace urbain, l’émergence d’un discours métrologique sur la nécessité d’une heure uniforme, partagée par tous les habitants de la ville.
Ces voies révèlent la conflictualité et la diversité des heures urbaines. Dans le Paris d’Ancien Régime, le temps n’est pas un service public coordonné, mais une information variable aux mains de corps politiques rivaux : fabriques de paroisse, échevinage, domaines royaux, corporations… Leurs archives révèlent que le réglage, le son et l’affichage de l’heure sont manipulés comme marqueurs de l’autorité et outils de pouvoir. Les horloges de rue, diversement réglées, génèrent des pratiques spécifiques : les citadins se déplacent pour acquérir, consulter, comparer des « heures de quartier », souvent en décalage. Ce n’est que lentement, à partir des années 1710, que se diffuse la pratique du réglage des montres personnelles sur le midi vrai, suscitant une première critique de l’information en termes de fiabilité et de justesse. Parallèlement, une littérature horlogère engage le débat sur la synchronisation des temps locaux : quel instrument doit faire autorité pour définir l’heure de Paris ? L’étude entend contribuer à l’historiographie de l’espace parisien moderne en insistant sur l’équipement de rue et les rivalités politiques pour la capacité à « faire signal ». Elle est aussi une histoire sociale de la technique, montrant l’interdépendance des différents types d’instruments et révélant des artisanats de l’heure méconnus. Elle est enfin une histoire des savoirs, examinant comment une littérature d’usage et l’apprentissage de gestes spécifiques interagissent pour faire émerger une science de la mesure au XVIIIe siècle. Elle propose au total une approche sociale d’un savoir de l’ordinaire, permettant d’historiciser les 24 heures de la journée en les observant comme le produit de conflits, de pratiques et de débats dans le temps long.
Mots clés :
Mesure du temps, horlogerie, gnomonique, histoire de l’heure, signalétique urbaine, équipement public, histoire urbaine, histoire de Paris, XVIIe siècle, pouvoirs urbains, échevinage, paroisses, bâtiments du roi.
Unité de Recherche : MéMo.
Directeur : M. Nicolas SCHAPIRA, Professeur des universités.
Jury :
Mme Liliane Hilaire-Pérez, Université Paris-Cité et EHESS (rapporteure)
M. Raphaël Morera, CNRS (rapporteur)
M. Gianenrico Bernasconi, Université de Neuchâtel
M. Robert Descimon, EHESS
Mme Corine Maitte, Université Gustave Eiffel
Résumé :
Ce travail propose d’étudier les formes, les acteurs et les pratiques du temps horaire à Paris à l’époque moderne. L’heure y est envisagée comme une information produite, diffusée et appropriée dans la ville : il s’agit de dépasser une approche limitée aux seules innovations techniques (comme la pendule ou le ressort spiral) au profit des interactions entre citadins, signalement de l’heure et paysage urbain. Ces relations évoluent au fil d’un long XVIIe siècle : notre parcours débute sur le pont au Change en 1585, devant l’horloge du Palais reconstruite pour Henri III, pour y revenir à la fin des années 1730, lorsque Jacques Cassini trace le « méridien de la Ville », instrument de référence pour le réglage des montres.
L’objet principal est l’heure de la rue, produite par un environnement signalétique dense et varié : horloges en gros volume, timbres et cloches, cadrans solaires et lignes méridiennes. L’étude se décline en trois axes : les acteurs produisant et entretenant l’information, le rapport de l’heure sonnée et affichée à l’espace urbain, l’émergence d’un discours métrologique sur la nécessité d’une heure uniforme, partagée par tous les habitants de la ville.
Ces voies révèlent la conflictualité et la diversité des heures urbaines. Dans le Paris d’Ancien Régime, le temps n’est pas un service public coordonné, mais une information variable aux mains de corps politiques rivaux : fabriques de paroisse, échevinage, domaines royaux, corporations… Leurs archives révèlent que le réglage, le son et l’affichage de l’heure sont manipulés comme marqueurs de l’autorité et outils de pouvoir. Les horloges de rue, diversement réglées, génèrent des pratiques spécifiques : les citadins se déplacent pour acquérir, consulter, comparer des « heures de quartier », souvent en décalage. Ce n’est que lentement, à partir des années 1710, que se diffuse la pratique du réglage des montres personnelles sur le midi vrai, suscitant une première critique de l’information en termes de fiabilité et de justesse. Parallèlement, une littérature horlogère engage le débat sur la synchronisation des temps locaux : quel instrument doit faire autorité pour définir l’heure de Paris ? L’étude entend contribuer à l’historiographie de l’espace parisien moderne en insistant sur l’équipement de rue et les rivalités politiques pour la capacité à « faire signal ». Elle est aussi une histoire sociale de la technique, montrant l’interdépendance des différents types d’instruments et révélant des artisanats de l’heure méconnus. Elle est enfin une histoire des savoirs, examinant comment une littérature d’usage et l’apprentissage de gestes spécifiques interagissent pour faire émerger une science de la mesure au XVIIIe siècle. Elle propose au total une approche sociale d’un savoir de l’ordinaire, permettant d’historiciser les 24 heures de la journée en les observant comme le produit de conflits, de pratiques et de débats dans le temps long.
Mots clés :
Mesure du temps, horlogerie, gnomonique, histoire de l’heure, signalétique urbaine, équipement public, histoire urbaine, histoire de Paris, XVIIe siècle, pouvoirs urbains, échevinage, paroisses, bâtiments du roi.
Mis à jour le 17 novembre 2025