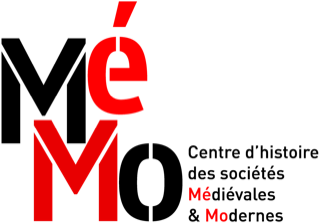Version française / Le laboratoire / Axes de recherche
Axes de recherche
Axe 1 – Histoire sociale et politique du fait religieux
L’axe « Histoire sociale et politique du fait religieux » constitue un pilier majeur du programme du MéMo, dont la vitalité repose sur des travaux variés et étroitement articulés autour de deux grandes thématiques : d’une part, l’insertion du religieux dans les structures sociales et politiques ; d’autre part, la fabrique, la mise en question et l’évolution des normes.
La première thématique explore la place des religieux dans les sociétés médiévales et modernes, en analysant leur inscription dans les tissus urbains, paroissiaux et politiques. Une étude comparative sur l’implantation des Carmes, ordre initialement érémitique, montre comment leur intégration sociale et spatiale diffère selon les villes, que ce soit par les appuis institutionnels, la participation aux processions, le développement foncier ou la politique édilitaire. D’autres recherches interrogent les relations entre communautés monastiques féminines et société urbaine, ou encore les activités des curés hors de leurs fonctions pastorales, comme la distribution de remèdes ou la publication de monitoires à fins de révélations, formes d’articulation entre justice ecclésiastique, justice royale et cura animarum.
Dans cette perspective, plusieurs enquêtes croisent aussi la question des usages sociaux de l’écrit religieux. Un chantier collectif porte sur les journaux et mémoires de curés, envisagés à la fois comme écriture personnelle et support de définition statutaire. En parallèle, un autre projet s’intéresse aux chroniques manuscrites produites par des religieuses du XVIe au XXIe siècle, afin d'analyser leur matérialité, leur portée historienne et les usages communautaires de ces récits. Ces travaux nourrissent une réflexion plus large sur les écritures religieuses et les modalités de transmission de la mémoire en milieu régulier.
Parallèlement, un second ensemble de recherches aborde les dimensions normatives du fait religieux, dans une perspective de longue durée. Le projet européen « ROTAROM », consacré à la Rote romaine, étudie la production et la circulation d’une culture juridique fondée sur la négociation, à travers les jurisprudences de ce tribunal pontifical. D’autres projets s’intéressent à l’écriture de la norme dans les congrégations religieuses ou aux processus réformateurs dans l’Europe du XVIIIe siècle. Un projet collectif, en cours d’élaboration, propose ainsi une réflexion transnationale sur l’histoire et l’historiographie des réformes, au-delà du seul cadre religieux.
Plusieurs travaux portent enfin sur les tensions entre norme et contestation. Une étude en cours sur le Traité des reliques de Guibert de Nogent examine la critique médiévale du culte des saints et ses implications théologiques et sociales. D’autres enquêtes analysent le rôle du religieux dans les dynamiques politiques et révolutionnaires, ou dans la fabrique de la violence, notamment dans le monde musulman ou dans le cadre des croisades, en lien avec les renouvellements récents de l’historiographie sur l’Orient latin.
La première thématique explore la place des religieux dans les sociétés médiévales et modernes, en analysant leur inscription dans les tissus urbains, paroissiaux et politiques. Une étude comparative sur l’implantation des Carmes, ordre initialement érémitique, montre comment leur intégration sociale et spatiale diffère selon les villes, que ce soit par les appuis institutionnels, la participation aux processions, le développement foncier ou la politique édilitaire. D’autres recherches interrogent les relations entre communautés monastiques féminines et société urbaine, ou encore les activités des curés hors de leurs fonctions pastorales, comme la distribution de remèdes ou la publication de monitoires à fins de révélations, formes d’articulation entre justice ecclésiastique, justice royale et cura animarum.
Dans cette perspective, plusieurs enquêtes croisent aussi la question des usages sociaux de l’écrit religieux. Un chantier collectif porte sur les journaux et mémoires de curés, envisagés à la fois comme écriture personnelle et support de définition statutaire. En parallèle, un autre projet s’intéresse aux chroniques manuscrites produites par des religieuses du XVIe au XXIe siècle, afin d'analyser leur matérialité, leur portée historienne et les usages communautaires de ces récits. Ces travaux nourrissent une réflexion plus large sur les écritures religieuses et les modalités de transmission de la mémoire en milieu régulier.
Parallèlement, un second ensemble de recherches aborde les dimensions normatives du fait religieux, dans une perspective de longue durée. Le projet européen « ROTAROM », consacré à la Rote romaine, étudie la production et la circulation d’une culture juridique fondée sur la négociation, à travers les jurisprudences de ce tribunal pontifical. D’autres projets s’intéressent à l’écriture de la norme dans les congrégations religieuses ou aux processus réformateurs dans l’Europe du XVIIIe siècle. Un projet collectif, en cours d’élaboration, propose ainsi une réflexion transnationale sur l’histoire et l’historiographie des réformes, au-delà du seul cadre religieux.
Plusieurs travaux portent enfin sur les tensions entre norme et contestation. Une étude en cours sur le Traité des reliques de Guibert de Nogent examine la critique médiévale du culte des saints et ses implications théologiques et sociales. D’autres enquêtes analysent le rôle du religieux dans les dynamiques politiques et révolutionnaires, ou dans la fabrique de la violence, notamment dans le monde musulman ou dans le cadre des croisades, en lien avec les renouvellements récents de l’historiographie sur l’Orient latin.
Axe 2 – Sociétés urbaines
L’axe « Sociétés urbaines » s’inscrit dans la continuité de l’ancien axe « Villes et société urbaine », tout en marquant une réorientation significative. Ce changement tient à la fois à un renouvellement des équipes et à l’ouverture vers de nouveaux champs d’étude. Les travaux partagent une approche commune de la ville comme espace social, en lien avec les dynamiques politiques, économiques et culturelles. L’élargissement géographique des terrains – au-delà de Paris – vers d’autres villes européennes, mongoles et ottomanes, favorise une lecture comparatiste.
Un premier ensemble de recherches porte sur les métiers urbains et les pratiques professionnelles. Plusieurs études croisent histoire sociale et économique : la médecine y est abordée en tant que pratique professionnelle, au-delà des sphères universitaires, à travers les apothicaires, barbiers et chirurgiens, analysés dans différentes villes d’Europe. On y observe les logiques de valorisation des savoir-faire, leur insertion dans le tissu urbain et les formes de reconnaissance sociale. Parallèlement, l’histoire des artistes du spectacle vivant au XVIIIe siècle interroge les formes d’entrepreneuriat liées à l’économie du spectacle, les lieux d’activité (théâtres, chapelles, palais) et la structuration des carrières artistiques à l’échelle urbaine et interurbaine. Ces recherches permettent de penser la ville comme lieu de circulation des savoirs, d’évaluation des compétences et de transformation des hiérarchies professionnelles.
Un deuxième axe se concentre sur l’inscription urbaine des cultures politiques. Les recherches sur les pratiques délibératives dans les communes italiennes du Moyen Âge analysent les dynamiques sociales et discursives au sein des conseils, tout en s’intéressant aux formes de politisation populaire hors des institutions. D’autres travaux cartographient les espaces de la politisation en contexte révolutionnaire, montrant comment tavernes, foires ou ports deviennent des lieux d’émergence de cultures politiques transnationales. L’interaction entre écrit et oral dans la gestion de la ville est également au cœur des recherches sur les journaux de procureurs syndics ou les systèmes d’information urbaine. L’ensemble de ces travaux éclaire la manière dont les villes produisent et reçoivent les discours politiques, et comment se construit la notion de bien commun.
Le troisième volet concerne la production historiographique en milieu urbain. L’étude des pratiques historiennes locales – chroniques, journaux, histoires de ville, vies de saints – permet d’analyser comment les communautés urbaines fabriquent leur mémoire et construisent leur identité. Une enquête régionale sur plusieurs villes de la Brie, du XVe au XVIIIe siècle, met en évidence la richesse de ces productions. D’autres travaux s’intéressent aux archives municipales, à leur transmission et à leur rôle dans l’affirmation du pouvoir urbain.
Enfin, un dernier ensemble de recherches explore la ville comme instrument ou terrain de conquête. L’implantation d’ordres religieux mendiants, comme les Carmes, et leur intégration dans le paysage urbain posent notamment la question des formes de visibilité et des fonctions sociales des religieux en ville. D’un autre côté, l’étude des villes fondées par les nomades dans l’empire mongol interroge leur rôle religieux, leur financement et les effets mémoriels de leur disparition.
Un premier ensemble de recherches porte sur les métiers urbains et les pratiques professionnelles. Plusieurs études croisent histoire sociale et économique : la médecine y est abordée en tant que pratique professionnelle, au-delà des sphères universitaires, à travers les apothicaires, barbiers et chirurgiens, analysés dans différentes villes d’Europe. On y observe les logiques de valorisation des savoir-faire, leur insertion dans le tissu urbain et les formes de reconnaissance sociale. Parallèlement, l’histoire des artistes du spectacle vivant au XVIIIe siècle interroge les formes d’entrepreneuriat liées à l’économie du spectacle, les lieux d’activité (théâtres, chapelles, palais) et la structuration des carrières artistiques à l’échelle urbaine et interurbaine. Ces recherches permettent de penser la ville comme lieu de circulation des savoirs, d’évaluation des compétences et de transformation des hiérarchies professionnelles.
Un deuxième axe se concentre sur l’inscription urbaine des cultures politiques. Les recherches sur les pratiques délibératives dans les communes italiennes du Moyen Âge analysent les dynamiques sociales et discursives au sein des conseils, tout en s’intéressant aux formes de politisation populaire hors des institutions. D’autres travaux cartographient les espaces de la politisation en contexte révolutionnaire, montrant comment tavernes, foires ou ports deviennent des lieux d’émergence de cultures politiques transnationales. L’interaction entre écrit et oral dans la gestion de la ville est également au cœur des recherches sur les journaux de procureurs syndics ou les systèmes d’information urbaine. L’ensemble de ces travaux éclaire la manière dont les villes produisent et reçoivent les discours politiques, et comment se construit la notion de bien commun.
Le troisième volet concerne la production historiographique en milieu urbain. L’étude des pratiques historiennes locales – chroniques, journaux, histoires de ville, vies de saints – permet d’analyser comment les communautés urbaines fabriquent leur mémoire et construisent leur identité. Une enquête régionale sur plusieurs villes de la Brie, du XVe au XVIIIe siècle, met en évidence la richesse de ces productions. D’autres travaux s’intéressent aux archives municipales, à leur transmission et à leur rôle dans l’affirmation du pouvoir urbain.
Enfin, un dernier ensemble de recherches explore la ville comme instrument ou terrain de conquête. L’implantation d’ordres religieux mendiants, comme les Carmes, et leur intégration dans le paysage urbain posent notamment la question des formes de visibilité et des fonctions sociales des religieux en ville. D’un autre côté, l’étude des villes fondées par les nomades dans l’empire mongol interroge leur rôle religieux, leur financement et les effets mémoriels de leur disparition.
Axe 3 – Corps, médecine, santé
L’axe « Corps, médecine, santé », récemment créé, répond à l’émergence d’un pôle de recherche dynamique autour de l’histoire de la médecine, du soin et des représentations du corps. Il s’appuie sur l’intégration de nouvelles enseignantes-chercheuses et sur des travaux antérieurement menés dans d’autres axes. Il articule une histoire des savoirs médicaux et des professions de santé avec une histoire sociale et culturelle du corps, de la souffrance et du soin, dans une perspective interdisciplinaire, comparatiste et diachronique, de l’Antiquité tardive au XVIIIe siècle.
Un premier volet s’attache aux pratiques concrètes du soin et à leurs acteurs. Il s’inscrit dans la continuité des rencontres d’histoire de la médecine organisées depuis plusieurs années, et a donné lieu en 2024 à un colloque international consacré à l’animal dans la maladie et la thérapie. Une synthèse sur l’histoire des malades avant la médecine contemporaine est également en préparation. Celle-ci s'appuie notamment sur des recherches menées à Paris et Londres à la fin du Moyen Âge, ou sur les pratiques pastorales liées à la distribution de remèdes au XVIIe siècle.
Les travaux s’intéressent aussi aux identités professionnelles des soignants, aux conflits de compétence et aux premières formes de responsabilité médicale. L’étude des contrats de soin, des attestations d’inaptitude au travail ou encore des décisions judiciaires permet d’éclairer la place des praticiens dans l’espace social et juridique. Les rapports entre municipalités et soignants sont également étudiés, notamment à travers les politiques d’emploi de praticiens communaux en Provence, inspirées du modèle italien.
Les recherches s’ouvrent enfin à la question des rapports de genre dans les milieux de soin, dans les relations entre soignants et patients, et dans les conceptions genrées du corps malade ou soigné.
Le second sous-axe est consacré à l’étude des savoirs médicaux et de leur circulation. Il s’agit de comprendre comment certains praticiens non diplômés accèdent aux savoirs par des traductions en langues vernaculaires, et comment ces textes participent à l'émergence d'une culture médicale partagée. L’intérêt pour la médecine dans les milieux religieux est aussi étudié à travers des textes produits ou transmis par des ordres comme les Carmes.
Un projet vise à constituer un corpus des traités de poisons médiévaux, encore peu édités, et à explorer les traditions manuscrites en langues latine, française et italienne. L’histoire intellectuelle de la médecine est également développée à travers des travaux sur la traduction du Canon d’Avicenne ou sur la scolastique médicale.
Enfin, plusieurs thèses en cours analysent les discours médicaux sur les menstruations ou les normes de genre au haut Moyen Âge, ce qui met en lumière les interactions entre savoir médical et représentations morales.
Un premier volet s’attache aux pratiques concrètes du soin et à leurs acteurs. Il s’inscrit dans la continuité des rencontres d’histoire de la médecine organisées depuis plusieurs années, et a donné lieu en 2024 à un colloque international consacré à l’animal dans la maladie et la thérapie. Une synthèse sur l’histoire des malades avant la médecine contemporaine est également en préparation. Celle-ci s'appuie notamment sur des recherches menées à Paris et Londres à la fin du Moyen Âge, ou sur les pratiques pastorales liées à la distribution de remèdes au XVIIe siècle.
Les travaux s’intéressent aussi aux identités professionnelles des soignants, aux conflits de compétence et aux premières formes de responsabilité médicale. L’étude des contrats de soin, des attestations d’inaptitude au travail ou encore des décisions judiciaires permet d’éclairer la place des praticiens dans l’espace social et juridique. Les rapports entre municipalités et soignants sont également étudiés, notamment à travers les politiques d’emploi de praticiens communaux en Provence, inspirées du modèle italien.
Les recherches s’ouvrent enfin à la question des rapports de genre dans les milieux de soin, dans les relations entre soignants et patients, et dans les conceptions genrées du corps malade ou soigné.
Le second sous-axe est consacré à l’étude des savoirs médicaux et de leur circulation. Il s’agit de comprendre comment certains praticiens non diplômés accèdent aux savoirs par des traductions en langues vernaculaires, et comment ces textes participent à l'émergence d'une culture médicale partagée. L’intérêt pour la médecine dans les milieux religieux est aussi étudié à travers des textes produits ou transmis par des ordres comme les Carmes.
Un projet vise à constituer un corpus des traités de poisons médiévaux, encore peu édités, et à explorer les traditions manuscrites en langues latine, française et italienne. L’histoire intellectuelle de la médecine est également développée à travers des travaux sur la traduction du Canon d’Avicenne ou sur la scolastique médicale.
Enfin, plusieurs thèses en cours analysent les discours médicaux sur les menstruations ou les normes de genre au haut Moyen Âge, ce qui met en lumière les interactions entre savoir médical et représentations morales.
Axe 4 – Pouvoirs, savoirs et pratiques de l’écrit
L’axe « Pouvoirs, savoirs et pratiques de l’écrit » constitue l’un des piliers scientifiques du MéMo pour les années 2024-2028. Il rassemble des chercheurs aux ancrages variés, qui interrogent l’écrit en croisant approches matérielles, philologiques, intellectuelles et sociales. La structuration de l’axe repose sur quatre grands pôles de recherche.
Le premier est consacré aux professionnels de l’écrit. L’étude des clercs, des secrétaires, des savants ou des enseignants éclaire leur rôle dans la production et la diffusion des savoirs comme dans l’organisation du pouvoir. L’analyse des pratiques scripturaires des curés, des secrétaires des chancelleries andalouses ou des praticiens de la médecine permet de mieux comprendre les logiques sociales et politiques qui sous-tendent l’activité d’écriture. Ces recherches abordent également les mécanismes de légitimation et les dynamiques professionnelles, notamment à travers les usages polémiques de l’information ou l’articulation entre compétence et statut social dans les mondes islamiques, chrétiens ou médicaux.
Le deuxième pôle concerne la critique et l’édition des sources. Plusieurs projets éditoriaux sont en cours, portant sur des documents variés : cartulaires, journaux de syndics, traités médicaux ou vénénologiques, recueils de facéties ou de traductions turques. L’édition critique s’accompagne d’une attention particulière à la genèse des textes, à leur matérialité et à leurs contextes de production. Ces travaux visent aussi à mieux comprendre la fonction sociale des écrits, qu’ils relèvent de la cure d’âme, de l’enseignement, de la diplomatie ou du divertissement.
Un troisième axe de réflexion s’attache à la fabrique des traditions historiographiques. L’analyse des narrations historiques, des chroniques, des topographies ou des récits exégétiques, dans l’Occident latin comme dans le monde islamique, permet de reconstituer les formes d’appropriation et de réinterprétation du passé. L’étude critique des traditions historiographiques, des usages du passé et de leurs circulations dans différents contextes s’inscrit aussi dans une interrogation plus large sur les conditions de production du savoir historique.
Enfin, un quatrième pôle explore la circulation et la réception des livres et des textes. L’histoire des bibliothèques, des archives et des pratiques de lecture, mais aussi des filières de production, de transport et de commercialisation de l’écrit, éclaire les modalités de diffusion du savoir. Les recherches portent aussi bien sur les réseaux de traduction, les bibliothèques féminines, les usages politiques de l’écrit, que sur la circulation du papier en Méditerranée.
Le premier est consacré aux professionnels de l’écrit. L’étude des clercs, des secrétaires, des savants ou des enseignants éclaire leur rôle dans la production et la diffusion des savoirs comme dans l’organisation du pouvoir. L’analyse des pratiques scripturaires des curés, des secrétaires des chancelleries andalouses ou des praticiens de la médecine permet de mieux comprendre les logiques sociales et politiques qui sous-tendent l’activité d’écriture. Ces recherches abordent également les mécanismes de légitimation et les dynamiques professionnelles, notamment à travers les usages polémiques de l’information ou l’articulation entre compétence et statut social dans les mondes islamiques, chrétiens ou médicaux.
Le deuxième pôle concerne la critique et l’édition des sources. Plusieurs projets éditoriaux sont en cours, portant sur des documents variés : cartulaires, journaux de syndics, traités médicaux ou vénénologiques, recueils de facéties ou de traductions turques. L’édition critique s’accompagne d’une attention particulière à la genèse des textes, à leur matérialité et à leurs contextes de production. Ces travaux visent aussi à mieux comprendre la fonction sociale des écrits, qu’ils relèvent de la cure d’âme, de l’enseignement, de la diplomatie ou du divertissement.
Un troisième axe de réflexion s’attache à la fabrique des traditions historiographiques. L’analyse des narrations historiques, des chroniques, des topographies ou des récits exégétiques, dans l’Occident latin comme dans le monde islamique, permet de reconstituer les formes d’appropriation et de réinterprétation du passé. L’étude critique des traditions historiographiques, des usages du passé et de leurs circulations dans différents contextes s’inscrit aussi dans une interrogation plus large sur les conditions de production du savoir historique.
Enfin, un quatrième pôle explore la circulation et la réception des livres et des textes. L’histoire des bibliothèques, des archives et des pratiques de lecture, mais aussi des filières de production, de transport et de commercialisation de l’écrit, éclaire les modalités de diffusion du savoir. Les recherches portent aussi bien sur les réseaux de traduction, les bibliothèques féminines, les usages politiques de l’écrit, que sur la circulation du papier en Méditerranée.
Axe transversal – Faire dialoguer Moyen Âge et Temps modernes
L’axe transversal du MéMo s’inscrit dans une réflexion historiographique et épistémologique de fond : celle de la périodisation historique et des frontières temporelles entre Moyen Âge et époque moderne. À rebours des découpages traditionnels, le laboratoire défend une approche critique des chrononymes et de leurs usages, dans la lignée des travaux de Jacques Le Goff sur le « long Moyen Âge » ou de Krzysztof Pomian sur les régimes de temporalité. Cette posture s’enrichit aussi des réflexions issues d’autres traditions académiques, qui remettent en question l’universalité de la périodisation européenne classique.
Le MéMo – parce qu'il réunit médiévistes et modernistes, mais aussi des chercheurs travaillant sur les mondes musulmans et asiatiques – constitue un lieu propice à cette mise en dialogue entre les périodes historiques. La confrontation des découpages temporels propres à chaque aire culturelle (par exemple, les phases « classique » ou « post-classique » de l’histoire islamique, ou les questionnements autour de la périodisation de l’Empire mongol) permet un véritable décentrement intellectuel. Cette approche invite à interroger les régimes d’historicité, tels que définis par François Hartog ou Reinhart Koselleck, et à examiner les synchronisations différenciées des temporalités culturelles.
Cet axe entend donc poser deux grandes questions : quels rapports au temps les sociétés médiévales et modernes ont-elles mis en œuvre ? Et comment, ou à quelles conditions, ont-elles pu rejoindre le régime de la modernité ? Ces interrogations, fondamentales, impliquent une mise en perspective comparatiste des cultures du temps et de leur historicisation.
Plusieurs initiatives concrètes ancrent déjà cette réflexion au sein du laboratoire. Une bibliographie de travail vise à recenser les avancées récentes sur la critique de la périodisation. Par ailleurs, plusieurs projets en cours incarnent cette dynamique : une journée d’étude sur les violences dans le monde islamique du XIIe au XVIIIe siècle, un travail sur les réécritures érudites de procès médiévaux à l’époque moderne, une participation au programme Renaissances, qui interroge la pertinence de ce terme historiographique, ou encore des recherches sur les engagements politiques à cheval entre histoire moderne et contemporaine.
Ces recherches convergent vers l’idée d’un dépassement des cloisonnements académiques entre les périodes et d’une attention renouvelée aux continuités et aux ruptures, tant dans les pratiques sociales que dans les catégories d’analyse. L’axe devrait déboucher à court terme sur un colloque collectif dédié, réunissant l’ensemble des membres du MéMo autour de cette interrogation centrale : comment penser le temps dans l’histoire ?
Mis à jour le 28 mars 2025