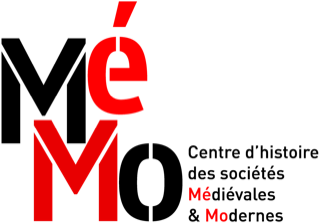Version française / Le laboratoire
Le laboratoire
Présentation du MéMo
Le laboratoire MéMo (Médiévistes et Modernistes de Paris 8 et de Paris Nanterre) est né d’une restructuration des équipes de recherche en histoire dans ces deux universités. Il s’inscrit dans une démarche comparatiste et transversale, consacrée à l’étude des sociétés européennes et islamiques entre le XIe et le XVIIIe siècle. Le laboratoire articule l’analyse des structures sociales, politiques, religieuses et économiques avec l’étude des processus de transformation vers la modernité. Il croise les trajectoires de l’Europe (notamment française et italienne) avec celles du monde islamique, dans ses composantes méditerranéennes (al-Andalus, Égypte, monde ottoman). Ce dialogue entre espaces et aires culturelles permet d’explorer à la fois les convergences et les spécificités de ces sociétés : écriture de gouvernement, structuration urbaine, affirmation des groupes religieux.
Axes de recherche et positionnement scientifique
Les membres de l’équipe s’intéressent à l’histoire entre le XIe et le XVIIIe siècle, une période envisagée dans la continuité de ses enracinements anciens — sociétés de la tradition, régimes anciens de croyances, de pouvoirs, de productions — comme de ses renouvellements, qui en font les ferments de notre modernité.
Le MéMo articule ses travaux autour de quatre axes scientifiques et d’un axe transversal.
Le MéMo articule ses travaux autour de quatre axes scientifiques et d’un axe transversal.
- L’axe 1 explore l’histoire sociale et politique du fait religieux, en croisant les dynamiques d’insertion des religieux dans les sociétés médiévales et modernes, l’étude des écrits produits par ces acteurs (journaux, chroniques, monitoires), et la fabrique normative (jurisprudences, réformes, critiques du culte). Il interroge également le lien entre religion et politique, en contexte européen ou islamique.
- L’axe 2, consacré aux sociétés urbaines, aborde la ville comme espace social, économique et politique. Il rassemble des recherches sur les métiers urbains (médecins, artistes, artisans), les cultures politiques (pratiques délibératives, politisation populaire), la production historiographique locale et la ville comme espace de conquête religieuse ou impériale.
- L’axe 3, « Corps, médecine, santé », analyse les milieux du soin et les savoirs médicaux dans une perspective interdisciplinaire. Il étudie les pratiques concrètes du soin, les rapports de genre dans les professions médicales, les textes médicaux vernaculaires, les responsabilités juridiques des praticiens, ou encore la constitution d’un corpus toxicologique.
- L’axe 4, « Pouvoirs, savoirs et pratiques de l’écrit », croise histoire sociale, politique et culturelle de l’écrit. Il s’organise autour de l’étude des professionnels de l’écrit, de l’édition de sources, de l’analyse des traditions historiographiques, et des circulations matérielles et intellectuelles des textes, des bibliothèques et des manuscrits.
- Enfin, l’axe transversal « Faire dialoguer Moyen Âge et Temps modernes » interroge les découpages temporels traditionnels et les régimes d’historicité. Il invite à penser les continuités, les ruptures et les temporalités différenciées entre les sociétés médiévales et modernes, en Europe comme dans les mondes islamiques.
Mis à jour le 08 avril 2025