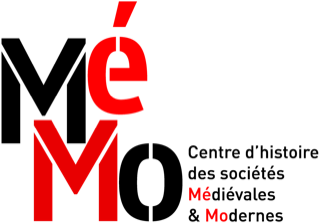Version française / Les membres / Soutenances
JULIEN BORTOLUSSI - Soutenance de thèse
Publié le 21 octobre 2025
–
Mis à jour le 5 novembre 2025
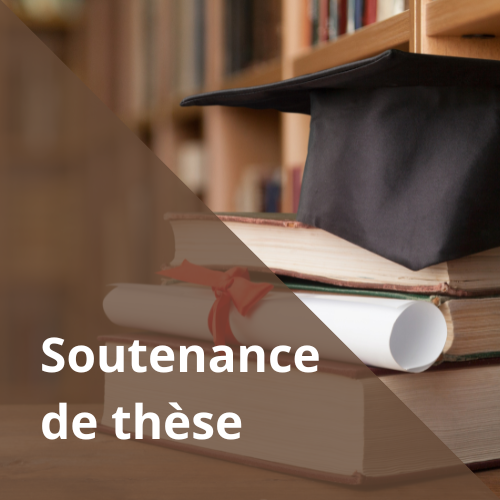
Les pratiques historiennes à Reims au XVIIe siècle. Le passé rémois au miroir du Grand Siècle.
Date(s)
le 8 novembre 2025
14h.
Lieu(x)
Université Paris Nanterre.
Salle B105.
Salle B105.
Section CNU : 22 - Histoire/civilisations : mondes modernes.
Unité de Recherche : MéMo
Directeur : M. Franck COLLARD, Professeur des universités ; M. Nicolas SCHAPIRA, Professeur des universités.
Jury :
Président :
Examinateurs : Véronique Beaulande-Barraud, Hilary Bernstein et Olivier Poncet.
Rapporteurs : Fanny Cosandey et Stefano Simiz
Résumé
Cette thèse vise à décrire la manière dont, à partir du début du XVIIe siècle, le passé rémois a fait l’objet de l’attention soutenue de plusieurs historiens, plus particulièrement Nicolas Bergier, Jean Rogier et Pierre Coquault. Ces trois auteurs s’inscrivent dans un contexte urbain en profond renouvellement politique, social et économique qui explique en partie pourquoi l’histoire de la ville est, à cette période, l’objet d’enjeux et de rivalités qui poussent les différentes institutions urbaines et leurs défenseurs à faire le choix, entre autres, de l’histoire comme un moyen d’affirmation et de protection de libertés et privilèges qui pouvaient paraître menacés. La manière dont les trajectoires sociales des différents auteurs se construisent et s’imbriquent a dès lors l’importantes conséquences sur leurs pratiques historiennes. Dans ce cadre, leur appartenance commune à l’élite rémoise les rapproche autant qu’elle les sépare, tant Reims apparaît comme une ville traversée de conflits et d’oppositions entre groupes.
Toutefois, si l’histoire de Reims telle qu’elle s’écrit au XVIIe siècle est résolument partisane, cela ne l’empêche pas de s’inscrire, aussi, dans un contexte intellectuel qui pousse les érudits à faire le choix d’une histoire fondée sur les preuves et la documentation archivistique. Une certaine culture commune de l’archive et du document est donc visible chez les praticiens de l’histoire rémoise, qui les place dans la continuité, notamment, des théoriciens de « l’histoire parfaite » du siècle précédent, tout en renforçant dans le même temps les rivalités institutionnelles, puisque les différentes organisations s’efforcent de contrôler l’accès à leurs archives afin de favoriser l’écriture d’histoires qui leurs soient favorables. Ce souci de l’érudition conduit aussi les Rémois à sortir largement du strict cadre urbain pour s’insérer dans des réseaux d’échanges et de communication à grande échelle, quand bien même, là aussi, de profondes divergences apparaissent entre eux. Cela signifie aussi que les usages de l’histoire qu’ils mettent en pratique ne peuvent toujours se limiter aux murailles de la ville : Reims, comme cité des sacres, possède une exceptionnalité dont ils ont conscience et dont ils savent tirer profit. Pourtant, si le sacre est au fondement de l’identité urbaine rémoise, il a aussi eu pour conséquences de tendre à masquer, ce faisant, l’immense difficulté, voire l’impossibilité, que les Rémois ont eu à construire une identité véritablement commune et partagée, dont témoigne la polyphonie historiographique.
Mots clés : Reims – Histoire – Pratique de l’écrit – Archives – Gouvernement municipal – Sacre – Gallicanisme – Histoire urbaine – Érudition – Identité urbaine.
Unité de Recherche : MéMo
Directeur : M. Franck COLLARD, Professeur des universités ; M. Nicolas SCHAPIRA, Professeur des universités.
Jury :
Président :
Examinateurs : Véronique Beaulande-Barraud, Hilary Bernstein et Olivier Poncet.
Rapporteurs : Fanny Cosandey et Stefano Simiz
Résumé
Cette thèse vise à décrire la manière dont, à partir du début du XVIIe siècle, le passé rémois a fait l’objet de l’attention soutenue de plusieurs historiens, plus particulièrement Nicolas Bergier, Jean Rogier et Pierre Coquault. Ces trois auteurs s’inscrivent dans un contexte urbain en profond renouvellement politique, social et économique qui explique en partie pourquoi l’histoire de la ville est, à cette période, l’objet d’enjeux et de rivalités qui poussent les différentes institutions urbaines et leurs défenseurs à faire le choix, entre autres, de l’histoire comme un moyen d’affirmation et de protection de libertés et privilèges qui pouvaient paraître menacés. La manière dont les trajectoires sociales des différents auteurs se construisent et s’imbriquent a dès lors l’importantes conséquences sur leurs pratiques historiennes. Dans ce cadre, leur appartenance commune à l’élite rémoise les rapproche autant qu’elle les sépare, tant Reims apparaît comme une ville traversée de conflits et d’oppositions entre groupes.
Toutefois, si l’histoire de Reims telle qu’elle s’écrit au XVIIe siècle est résolument partisane, cela ne l’empêche pas de s’inscrire, aussi, dans un contexte intellectuel qui pousse les érudits à faire le choix d’une histoire fondée sur les preuves et la documentation archivistique. Une certaine culture commune de l’archive et du document est donc visible chez les praticiens de l’histoire rémoise, qui les place dans la continuité, notamment, des théoriciens de « l’histoire parfaite » du siècle précédent, tout en renforçant dans le même temps les rivalités institutionnelles, puisque les différentes organisations s’efforcent de contrôler l’accès à leurs archives afin de favoriser l’écriture d’histoires qui leurs soient favorables. Ce souci de l’érudition conduit aussi les Rémois à sortir largement du strict cadre urbain pour s’insérer dans des réseaux d’échanges et de communication à grande échelle, quand bien même, là aussi, de profondes divergences apparaissent entre eux. Cela signifie aussi que les usages de l’histoire qu’ils mettent en pratique ne peuvent toujours se limiter aux murailles de la ville : Reims, comme cité des sacres, possède une exceptionnalité dont ils ont conscience et dont ils savent tirer profit. Pourtant, si le sacre est au fondement de l’identité urbaine rémoise, il a aussi eu pour conséquences de tendre à masquer, ce faisant, l’immense difficulté, voire l’impossibilité, que les Rémois ont eu à construire une identité véritablement commune et partagée, dont témoigne la polyphonie historiographique.
Mots clés : Reims – Histoire – Pratique de l’écrit – Archives – Gouvernement municipal – Sacre – Gallicanisme – Histoire urbaine – Érudition – Identité urbaine.
Mis à jour le 05 novembre 2025