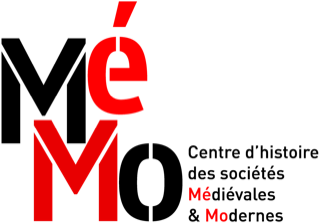Version française / Activités scientifiques / Colloques et rencontres
Faire corps en chrétienté (Moyen Âge - Epoque moderne)
Publié le 20 février 2025
–
Mis à jour le 27 mars 2025
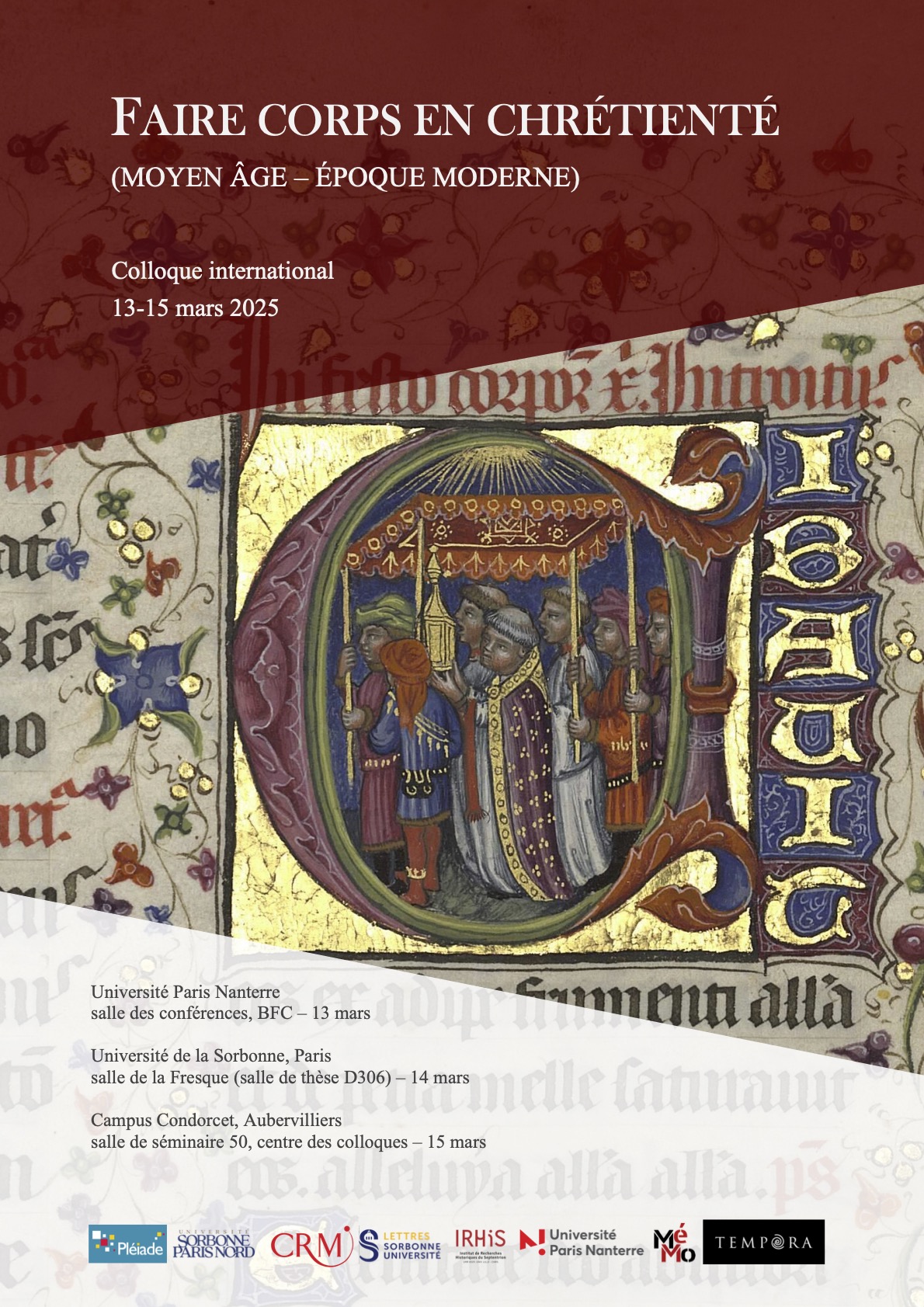
Date(s)
du 13 mars 2025 au 15 mars 2025
Lieu(x)
Université Paris Nanterre, Nanterre
Sorbonne Université Lettres, Paris
Campus Condorcet, Aubervilliers
Sorbonne Université Lettres, Paris
Campus Condorcet, Aubervilliers
Dans sa première épître aux Corinthiens, l’apôtre Paul avait adopté la métaphore du corps pour évoquer la diversité des charismes et des fonctions au sein de la communauté chrétienne : tous membres de l’unique corps du Christ, les croyants ont chacun leur place et leur utilité, selon le don propre reçu de Dieu. La métaphore organiciste a par la suite été souvent reprise, avec les principes qu’elle véhiculait : indivisibilité, complémentarité et interdépendance, hiérarchie. Elle a en outre été appliquée à l’Ecclesia comprise au sens large, le corps religieux mais aussi social et politique. Ce schéma général n’excluait pas l’existence de « corps intermédiaires » : communautés et ordres religieux, chapitres, confréries, confraternités de prière… À côté de ces corps institutionnalisés et définis par le droit, de quelle reconnaissance ou sentiment d’appartenance étaient accompagnés des groupes et communautés plus informels, tels, entre autres, les romieux et jacquets cheminant vers leur destination ou revenus d’un même pèlerinage ?
Il y avait en tout cas diverses manières de faire corps en Occident au Moyen Âge et à l’Époque moderne, à différentes échelles : quels étaient alors les éléments permettant à un groupe de s’identifier comme corps, comme communauté – et ces deux termes étaient-ils équivalents ? Dans quelle mesure reprenait-on et déclinait-on la métaphore organiciste ? L’a-t-on parfois écartée en rejetant certains traits (hiérarchie, non-interchangeabilité des fonctions…) et dans ce cas, des modèles alternatifs ont-ils été proposés ?
On s’interrogera aussi sur la manière dont les différents corps se situaient et interagissaient, non sans conflits parfois, au sein de l’unique « corps du Christ » qu’était l’Église considérée dans sa totalité, et sur la façon de reconnaître et de gérer au sein des communautés particulières les tensions, les dissensus sinon les dissidences. L’on portera évidemment tout autant attention aux manifestations d’un « esprit de corps » et aux formes de solidarité qu’impliquait cette cohésion, avec ses différents champs d’application, matériels et spirituels. En corollaire, la force du collectif et la manière dont il limitait ou non l’expression d’aspirations et d’expériences individuelles ne manqueront pas d’être scrutées. Il faudra également considérer la dialectique entre l’exigence de durée et de stabilité, garantie de la permanence du corps, et les dynamiques et évolutions qui sont la caractéristique d’un corps vivant, autrement menacé de dépérissement.
À partir des XIe-XIIe siècles, « faire corps » prend une résonance nouvelle avec l’essor de la doctrine et de la piété eucharistiques ; les liens entre corps sacramentel et corps mystique sont redéfinis. Par la vue ou la manducation, l’eucharistie met aussi en jeu le corps charnel de chaque fidèle ; l’appartenance au corps ecclésial engage ainsi la personne du croyant jusque dans sa dimension physique. Au-delà de la vénération croissante dont fut entouré le Corpus Christi, on pourra s’interroger plus largement sur la discipline des corps : dans quelle mesure l’injonction de faire corps s’est-elle cristallisée ici et là dans des gestes, des attitudes, des tenues ou codes vestimentaires ?
Dans la géographie mentale et spirituelle de l’Occident médiéval, « faire corps » dépasse les frontières du monde visible. Les composantes du corps ecclésial se démultiplient : par la communion des saints, l’Église militante est reliée à l’Église triomphante, mais aussi et toujours plus à l’Église souffrante ou pénitente – les âmes du purgatoire. Des solidarités unissent ainsi les vivants et les morts, mais également les êtres humains et les anges. La perspective eschatologique, toujours présente, dessine une manière idéale et définitive de faire corps, au sein d’une cour céleste dont tous les membres seront enfin rassemblés.
En conjuguant ces approches, il sera sans doute possible de mieux comprendre la manière propre dont le christianisme a contribué à la formation de communautés concrètes ou virtuelles, au regard d’autres corps constitués et d’autres communautés – dont un même fidèle était aussi, le plus souvent, partie prenante.
Programme
Jeudi 13 MARS 2025
Université Paris Nanterre
(Salle des conférences, Bâtiment de la Formation Continue, allée de la gare, Nanterre : plan d'accès ici)
9h30 – Accueil des participants
9h45 – Mot d’accueil : Anne Bonzon (Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis, codirectrice du MéMo), Franck Collard (Université Paris Nanterre, directeur de l’UFR SSA), Emmanuelle Tixier du Mesnil (Université Paris Nanterre, codirectrice du MéMo)
10h00 – Introduction : Marie-Madeleine de Cevins, Esther Dehoux, Marielle Lamy, Olivier Marin, Matthieu Rajohnson
Session 1. Corps métaphorique et corps de chair
Présidence : François Bougard (Institut de Recherche en Histoire des Textes)
10h25 – Françoise Laurent (Université Clermont Auvergne) : « Trop Grant religïun ne volt dehors mostrer / Mes les dous ordres volt en un sul cors porter ». Corps charnel, corps ecclésial dans la Vie de saint Thomas de Canterbury de Guernes de Pont-Sainte-Maxence
10h50 - pause
11h10 – Matthieu Rajohnson (Université Paris Nanterre) : « Faire corps avec le Christ » : métaphores corporelles d’une union spirituelle dans le De pigneribus de Guibert de Nogent
11h35 – Marielle Lamy (Sorbonne Université Lettres) : Sub tuum praesidium. Faire corps à l’ombre de la Vierge, entre universalité et particularismes
Discussion
12h15-14h : Déjeuner
Session 2.1 Ordres et corps religieux (I)
Présidence : André Vauchez (Académie des Inscriptions et Belles Lettres)
14h15 – Anne Reltgen-Tallon (Université de Picardie-Jules Verne) : Faire corps malgré le genre : la problématique place des femmes chez les Mendiants au miroir de la littérature dominicaine
14h40 – Ludovic Viallet (Université Clermont Auvergne) : Corps emboités ? Les réformes dans la famille “franciscaine”, autour de Colette de Corbie
15h05 – Marie-Madeleine de Cevins (Université Rennes 2) : Les rituels d’entrée en confraternité chez les Prêcheurs à la lumière des sources hongroises (v. 1240-v. 1530)
Discussion
15h45 : pause
Session 2.2 Ordres et corps religieux (II)
Présidence : Laurence Moulinier-Brogi (Université Paris Nanterre)
16h15 – Umberto Longo (Sapienza Università di Roma) : Corps individuel, corps communautaire dans les nouvelles communautés érémitiques de réforme du XIe siècle. La pensée de Pierre Damien.
16h40 – Angela Laghezza (Università degli studi di Bari Aldo Moro) : Fare comunità in tempo di crisi. Il culto di santa Fara a Faremoutiers nel XVII secolo
17h05 – Caroline Galland (Université Paris Nanterre) : (Re)penser le corps social au siècle des Lumières : incorporer les « réguliers » dans le droit français
Discussion
Vendredi 14 MARS 2025
Université Paris Sorbonne("Salle de la Fresque" (salle de thèse D306 ; accès par la cour d'honneur), Sorbonne, rue Victor Cousin, Paris ; attention, en raison des conditions d'accès au site de la Sorbonne, il est impératif de se munir d'une pièce d'identité et de s'inscrire via ce lien d'ici le 9 mars pour accéder aux sessions du vendredi)
9h15 – Accueil
Session 3. Place des laïcs dans le corps ecclésial
Présidence : Jacques Verger (Académie des Inscriptions et Belles Lettres)
9h30 – Alexis Fontbonne (Université de Namur) : Un corps légitime de laïcs inspirés : les confréries du Saint-Esprit, présentation générale et exemple colonais
9h55 – Séverine Sureau-Niveau (MéMo) : La communauté hospitalière de l’Aumône Notre-Dame de Chartres aux XIVe et XVe siècles
Discussion
10h35 - pause
10h50 – Stefano Simiz (Université de Lorraine) : Quelle place pour les laïcs dans une Église en transition ? À propos du traité de René Benoist, De l’institution et de l'abus survenu es confraries populaires: avec la reformation necessaire en icelles (1578)
11h15 – Jean-Pierre Bordier (Université Paris Nanterre) : Les mystères et le corps de l’Église : corps ecclésial, corps saint, corps civique
Discussion
12h-14h : Déjeuner
Session 4. Faire corps en pèlerinage
Présidence : Cécile Caby (Sorbonne Université)
14h15 – Françoise Perrot (CNRS / LAMOP) : La croisade, un « corps constitué » chrétien, et son évocation dans le vitrail
14h40 – Catherine Guyon (Université de Lorraine) : Faire corps en cheminant vers Sainte-Catherine du Mont Sinaï (XIVe-XVe siècle)
15h05 – Marie-Christine Gomez-Géraud (Université Paris Nanterre) : Faire corps en pèlerinage. Du rite à la mémoire
Discussion
15h45 : Pause
Session 5. Des élaborations pratiques aux conceptions intellectuelles
Présidence : Marie-Madeleine de Cevins (Université Rennes 2)
16h15 – Amandine Le Roux (LAMOP) : L’élaboration des pratiques corporatives chez les collecteurs pontificaux
16h40 – Franck Collard (Université Paris Nanterre) : Penser l’Église comme corps. Le corpus ecclesiale conçu par quelques chroniqueurs et historiens français de la fin du Moyen Âge
17h05 – François Wallerich (FNRS / Université de Louvain) : Commenter, représenter et s’approprier le Symbole des Apôtres. Des techniques intellectuelles pour faire Église (XIIIe-XVe siècle)
Discussion
Samedi 15 MARS 2025
Campus Condorcet(Salle de séminaire 50, Centre des colloques, place du Front populaire, Aubervilliers)
9h15 – Accueil
Session 6. Faire corps par-delà la mort
Présidence : Anne Bonzon (Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis)
9h30 – Esther Dehoux (Université de Lille) : « Sed quia omnes ex uno Patre geniti sumus et ex una carne procreati sumus » : sollicitations de prières dans les tituli des rouleaux des morts (milieu du IXe-milieu du XIIIe siècle)
9h55 – Olivier Marin (Université Sorbonne – Paris Nord) : La potence et l'autel : la communion eucharistique des condamnés à mort en Europe centrale (XIVe-XVe siècles)
10h20 – Ada Campione (Università degli studi di Bari Aldo Moro) : La solidarietà del dolore nei santuari à répit : l’esperienza di una chiesa oltre la Chiesa
Discussion
11h – pause
11h30 – Conclusions par Nicole Bériou (Académie des Inscriptions et Belles Lettres)
Déjeuner
Comité d'organisation et contacts :
Marie-Madeleine de Cevins
Esther Dehoux
Marielle Lamy
Olivier Marin
Matthieu Rajohnson
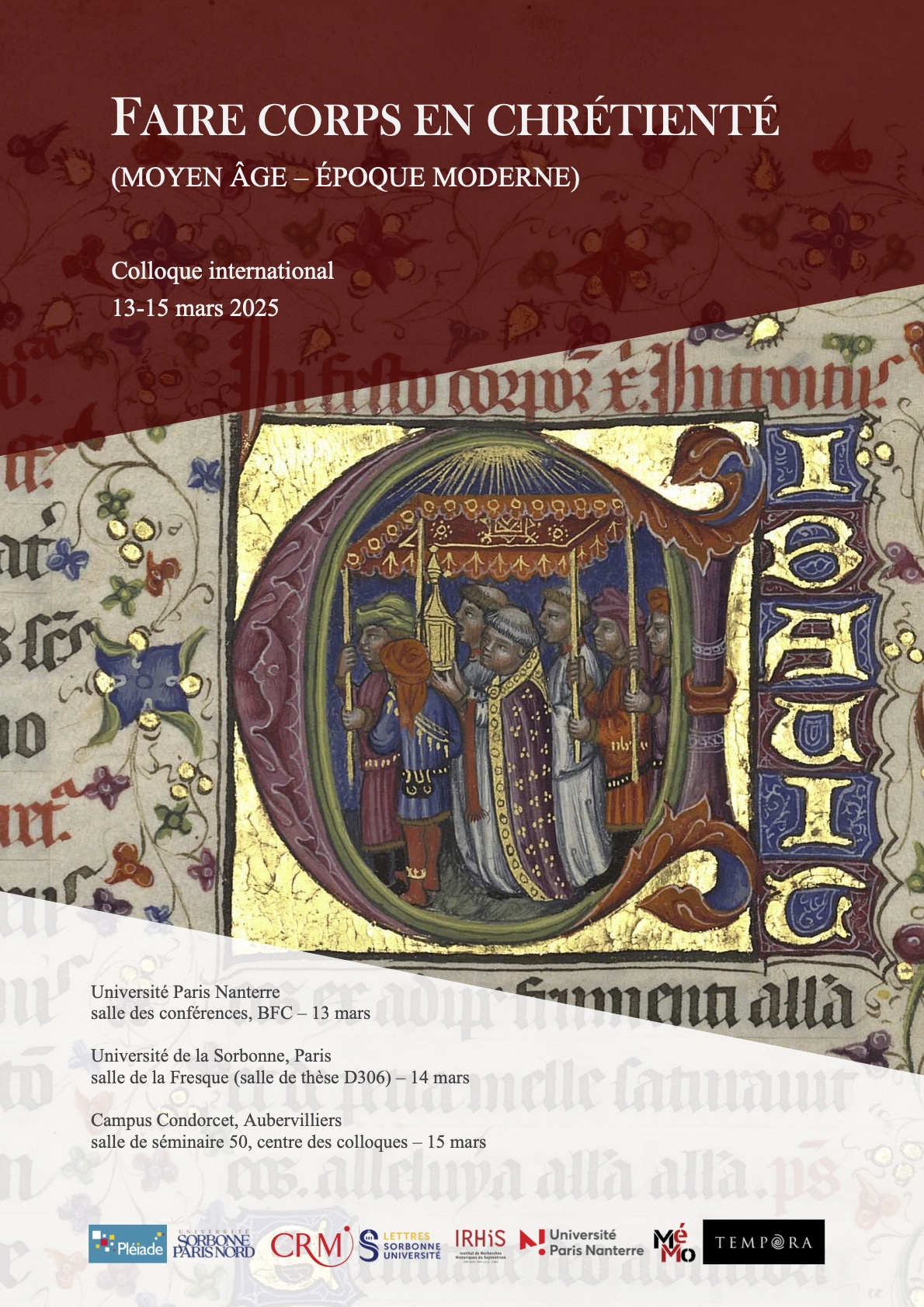
Mis à jour le 27 mars 2025